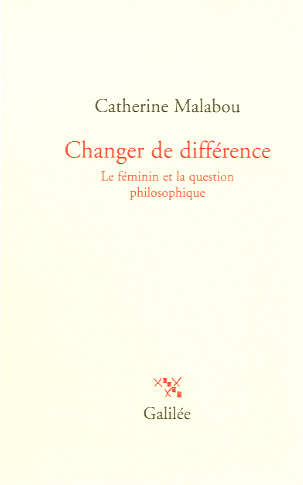Catherine Malabou : "La philosophie a orchestré l'impossibilité de la femme comme sujet"
LE MONDE DES LIVRES | 17.12.09
LINK
Catherine Malabou n'a manifestement pas le goût des territoires et des routines. En retrouvant la philosophe dans un café bondé et quelque peu bruyant du 1er arrondissement de Paris, on comprend aussitôt qu'elle préfère les espaces ouverts à la quiétude du logis, et la foule au confort de l'intimité.
C'est d'ailleurs très bien ainsi, et le dialogue n'en pâtira pas. Car on découvre aussi que cette intellectuelle protéiforme est une interlocutrice attentive et passionnée. Elle semble d'ailleurs plus intéressée par l'autre que par elle-même, curieuse d'épier ses réactions et de savoir ce qu'il pense de son travail. Surprise, presque, qu'on s'intéresse à elle.
Elle dira être née en Algérie, avouera être normalienne, évoquera la thèse sur Hegel qu'elle a rédigée sous la direction de Jacques Derrida (dont elle fut un "compagnon de route"). Elle enseigne également à l'université de Nanterre et aux Etats-Unis. Pour le reste ? "Vous savez, élude-t-elle, ma vie n'est pas très intéressante." On se tourne alors vers ses concepts, et à l'évidence, cela lui convient mieux. Celui de "plasticité", notamment, qu'elle a justement découvert chez Hegel et n'a cessé d'élaborer depuis, pour en explorer toutes les implications.
La plasticité, c'est l'aptitude à maintenir une identité tout en évoluant, en muant, en se transformant au contact de l'environnement et selon les aléas des circonstances. En neurologie, la plasticité cérébrale désigne la capacité qu'ont les synapses de moduler leur fonctionnement sous l'effet de l'expérience, donc de l'apprentissage, ce qui signifie que le cerveau n'est pas "rigide", mais évolutif, ouvert, en transformation constante.
Elle raconte en souriant que cette orientation décisive de son travail s'est dessinée initialement par hasard. "J'étais tombée sur un numéro de la revue La Recherche qui portait sur la mémoire, et dont l'un des articles évoquait la plasticité neuronale. Je me suis rendue compte que c'était exactement cela que je travaillais chez Hegel..."
Rencontre fortuite
Ce qui l'a intéressée dans cette rencontre fortuite, c'était d'y trouver "la traduction d'un concept dans les choses mêmes", l'incarnation imprévue d'un pur objet de pensée dans un problème concret. Et c'est dans cette optique qu'elle a mené de nombreux travaux sur les neurosciences (on mentionnera notamment Que faire de notre cerveau ?, Bayard, 2004 ; et La Chambre du milieu. De Hegel aux neurosciences, Hermann, 2009), cherchant à traiter par ce biais un problème à la fois politique et métaphysique, celui de la liberté. Comment penser cette dernière comme, non pas conquise contre l'inertie physique et le déterminisme naturel, mais directement inscrite dans le corps, immanente aux replis de la matière ?
Mais la question qui, aujourd'hui, habite Catherine Malabou avec le plus d'intensité est celle du féminisme. Sa réflexion prend sa source dans un constat radical. "La philosophie a orchestré l'impossibilité de la femme comme sujet." Et il lui semble que le discours dominant du féminisme, qui consiste en une critique de l'essentialisme et affirme qu'il n'y a pas d'identité propre du féminin, reconduit paradoxalement cette violence symbolique."Il est symptomatique, remarque-t-elle, qu'aucune femme ne se revendique vraiment philosophe, comme si elles ne s'en sentaient pas le droit."
Elle considère qu'il est nécessaire de sortir de cette impasse et d'assumer le fait qu'il existe quelque chose comme une spécificité du féminin. Et, puisque la femme s'est toujours définie par la violence qui lui était faite, il faut prendre au mot l'assimilation du féminin à un "rien d'être" et le redéfinir comme " essence vide mais résistante".
"Résistante" est ici le mot-clé. Catherine Malabou refuse avec la dernière énergie toute posture de victimisation. Lui demande-t-on d'évoquer son propre statut de femme-philosophe, les blocages qu'elle a pu rencontrer, la brutalité des luttes de territoire et autres bagarres de bac à sable dans lesquelles se complaît si souvent l'institution universitaire ? Elle commence à s'exécuter du bout des lèvres, puis écarte bien vite ces considérations d'un haussement d'épaules : "Ce n'est pas très grave, je me suis débrouillée." Il suffit de ne pas rentrer dans le jeu et, encore une fois, d'être mobile, plastique. En voyageant, par exemple. Et c'est sans doute la raison pour laquelle elle passe de plus en plus de temps aux Etats-Unis (où elle enseigne un semestre par an à l'université de Buffalo comme visiting professor).
Elle y a rencontré, dit-elle, une tout autre manière de poser les problèmes théoriques et politiques, d'être professeur, d'être militante, d'être féministe. C'est comme une véritable cure de relativisme culturel qu'elle évoque ses séjours américains. "On ne peut plus se réfugier derrière une illusoire tradition française d'excellence. On n'est plus le même quand on enseigne là-bas, et en anglais." Elle ajoutera dans un demi-sourire que "la gauche américaine est tout de même plus vivante que la nôtre"...
Il est un sujet, toutefois, qu'elle aborde avec, sinon une tristesse, du moins une déception perceptible : la "fin de non-recevoir" adressée par les politiques à La Grande Exclusion. L'urgence sociale, symptôme et thérapeutique (Bayard, 2009), l'ouvrage qu'elle a coécrit avec Xavier Emmanuelli, le fondateur du SAMU Social. Catherine Malabou confesse même, sur ce point, une certaine naïveté. "Je croyais que c'était un combat plus reconnu politiquement. Mais le problème des grands exclus n'est pas pris en compte en dehors du tintamarre télévisuel et des autoroutes de la charité." Il s'agissait justement pour elle de faire de la grande exclusion un problème proprement politique, et plus seulement un "sujet social", et elle ne peut dissimuler sa colère devant le fait que nos dirigeants fassent la sourde oreille.
"Des gens meurent dans la rue, conclut-elle lapidairement. Mais apparemment il y a des questions brûlantes qui ne sont pas brûlantes pour tout le monde."
Stéphane Legrand
Showing posts with label philosophy. Show all posts
Showing posts with label philosophy. Show all posts
Tuesday, March 13, 2012
Tuesday, February 7, 2012
Vahanian's ''A Conversation with Malabou''
Noelle Vahanian's 2008 interview with Malabou (Journal for Cultural and Religious Theory 9:1) can be found here
Saturday, February 4, 2012
Books
voir venir
"What is it that summons us to write when the time of the book, determined by a relation of beginning-end, and the space of the book, determined by deployment from a center, cease to impose themselves? The attraction of (pure) exteriority." Blanchot
*
2012
Self and Emotional Life: Merging Philosophy, Psychoanalysis, and Neuroscience, with Adrian Johnston, Columbia UP
The Ontology of the Accident: An Essay on Destructive Plasticity, Polity
The New Wounded: From Neurosis to Brain Damage, Fordham UP
translation of Les nouveaux blessés (2007)
Que faire de notre cerveau?, 2nd édition, Bayard
Beynimizle Ne Yapmalıyız?, Küre Yayınları
Turkish translation of Que faire de notre cerveau? (2004)
Benim İçin Bedenim Ol: Tinin Görüngübilimi'nde Beden, Şekil ve Plastikiyet, Açılım Kitap
I nuovi feriti della mente. Da Freud alla neurologia, pensare i traumi contemporanei, O Barra O Edizioni
Italian translation of Les nouveaux blessés (2007)
*
2011
The Heidegger Change: On the Fantastic in Philosophy, SUNY Press
translation of Le Change Heidegger (2004)
Changing Difference, Polity
translation of Changer de différence (2009)
Ontologie des Akzidentiellen: Essay zur zerstörerischen Plastizität, Merve Verlag
German translation of Ontologie de l'accident (2009)
Bodi moje telo! Dialektika, dekonstrukcija, spol, Zalozba Krtina [Slovenian]
Wat te doen met ons brein, Boom
Dutch translation of Que faire de notre cerveau? (2004)
La Plasticidad en Espera. Santiago de Chile : Palinodia.
*
2010
Sois mon corps : Une lecture contemporaine de la domination et de la servitude chez Hegel, with Judith Butler, Bayard
in English: ''You Be My Body for Me: Body, Shape, and Plasticity in Hegel’s Phenomenology of Spirit'' in A Companion to Hegel (Wiley-Blackwell 2011, eds. Houlgate and Baur)
*
2009
Ontologie de l'accident: Essai sur la plasticité destructrice, Léo Scheer
La grande exclusion : L'urgence sociale, symptôme et thérapeutique, with Xavier Emmanuelli, Bayard
La chambre du milieu: De Hegel aux neurosciences, Hermann
Changer de différence: Le féminin et la question philosophique, Editions Galilée
*
2008
What Should We Do with Our Brains, Fordham UP
translation of Que faire de notre cerveau? (2004)
La plasticidad en el atardecer de la escritura, Ellago
Spanish translation of La plasticité au soir de l'écriture (2004)
*
2007
Les nouveaux blessés: De Freud à la neurologie, penser les traumatismes contemporains, Bayard
Que hacer con nuestro cerebro, Arena Libros
Spanish translation of Que faire de notre cerveau? (2004)
Was tun mit unserem Gehirn?, Diaphanes
German translation of Que faire de notre cerveau? (2004)
Cosa fare del nostro cervello?, Armando Editore
Italian translation of Que faire de notre cerveau? (2004)
*
2006
La plasticité au soir de l'écriture: Dialectique, destruction, déconstruction, Léo Scheer
*
2005
ヘーゲルの未来―可塑性・時間性・弁証法
Hegel no mirai, tr. de Yuji Nishiyama, Tokyo, Mirai Sha, 2005.
Japanese translation of L'avenir de Hegel (1996)
わたしたちの脳をどうするか―ニューロサイエンスとグローバル資本主義
Translated by Kohei Kuwada and Bunishiro Masuda, Tokyo: Shunjusha
Japanese translation of Que faire de notre cerveau? (2004)
*
2004
Que faire de notre cerveau?, Bayard
The Future of Hegel: Plasticity, Temporality and Dialectic, Routledge
translation of L'avenir de Hegel (2000)
Counterpath, with Jacques Derrida, Stanford University Press
*
1999
Plasticité, Léo Scheer
Voyager avec Jacques Derrida – La Contre-allée, with Jacques Derrida, La Quinzaine littéraire-Louis Vuitton
*
1996
L'avenir de Hegel : Plasticité, temporalité, dialectique, Vrin
*
1990
Edited Revue Philosophique's special issue on Derrida (April-June, no.2)
Labels:
catherine malabou,
Changer de différence,
changing difference,
Emotional Life,
neuroscience,
philosophy,
Psychoanalysis,
Que faire de notre cerveau,
Self,
Sois mon corps,
The Heidegger Change
Malabou - Changer de différence (2009)
Que la « femme » se trouve désormais, à l’âge du post-féminisme, privée de son « essence », ne fait paradoxalement que confirmer un très ancien état de fait : la « femme » n’a jamais pu se définir autrement que par la violence qui lui est faite. Cette violence seule lui confère son être. Violence domestique et sociale d’une part, violence théorique de l’autre. La critique de l’« essentialisme » (il n’y a pas d’essence spécifiquement féminine) par la théorie des genres et la déconstruction ajoute un tour de plus à la négation ontologique du féminin.
Cet évidement toujours plus radical de la femme au sein de mouvements de pensée censés la protéger, cette assimilation de la femme à un « rien d’être » ouvrent, contre toute attente, une nouvelle voie. Acceptons donc de penser, sous le nom de « femme », une essence vide mais résistante, résistante parce que vide, qui frappe définitivement d’impossibilité sa propre disparition. Interroger ce qui reste de la femme après le sacrifice de son être pourrait marquer, au-delà de l’essentialisme comme de l’anti-essentialisme, une nouvelle ère de la lutte féministe et orienter autrement le combat.
On commence ici avec la philosophie en demandant : qu’est-ce, pour une femme, qu’une vie de philosophe ?
C. M.
Labels:
catherine malabou,
changing difference,
deconstruction,
derrida,
femme,
philosophie,
philosophy,
women
Subscribe to:
Posts (Atom)